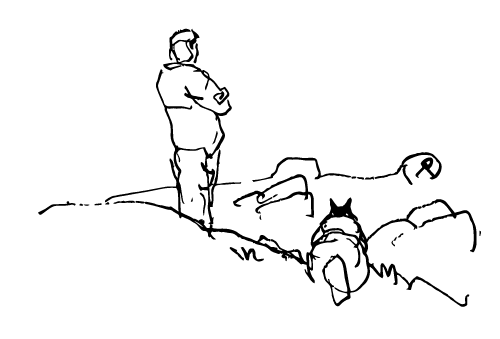Le dispositif Alpages Sentinelles
Un réseau dynamique sur les Alpes
« Alpages Sentinelles » regroupe à l’échelle du massif alpin une vingtaine de partenaires scientifiques, techniques, territoriaux et institutionnels. La vie du réseau est rythmée par différents moments et lieux d’échange :
- des visites d’alpage lors de tournées de fin d’estive, avec les éleveurs et bergers ;
- des groupes de travail thématiques entre référents techniques, scientifiques et territoriaux ;
- des rencontres au sein de chacun des territoires du dispositif ;
- des réunions annuelles regroupant l’ensemble des acteurs du réseau.
Ces échanges contribuent à bâtir une culture commune autour de l’alpage et des enjeux liés au changement climatique à l’échelle alpine. Ils permettent également de croiser les apports et expertises des différents acteurs du dispositif.
Un vaste réseau de partenaires
La richesse des échanges et des apports au sein du réseau est liée à la diversité et à la complémentarité des multiples partenaires techniques, scientifiques, territoriaux, politiques et financiers. La forte implication des services pastoraux (CERPAM, ADEM, SEA73, SEA74, FAI) auprès des éleveurs et bergers permet ainsi de faire le lien au sein du réseau entre expertise de terrain et fondamentaux scientifiques. Elle joue aussi un rôle essentiel dans la création et la diffusion des outils opérationnels développés par « Alpages Sentinelles ».
Par ailleurs, le dispositif « Alpages Sentinelles » est intégré à la dynamique Sentinelles des Alpes, portée par la Zone Atelier Alpes, une action partenariale relative à cinq dispositifs d’observation des relations Climat-Biodiversité-Homme dans les Alpes.
« Alpages Sentinelles » échange ainsi régulièrement avec les réseaux suivant : « Refuges Sentinelles » (observatoire des transformations climatiques et culturelles en haute montagne, « Lacs Sentinelles » (dispositif pour la connaissance et la gestion des lacs d’altitude), « Flore Sentinelle » (réseau de conservation de la flore patrimoniale), « Orchamp » (observatoire des relations climat / homme / milieux sur le massif alpin).
Un dispositif porté par des territoires d’espaces naturels protégés
Après un coup d’envoi initié par le Parc National des Ecrins en 2007, les alpages sentinelles se sont déployés dans les Alpes essentiellement sur des territoires d’espaces naturels protégés : Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, et zone Natura 2000 hors parcs.
Les moyens humains et financiers mobilisables par les structures en charge de ces espaces, et leur pérennité dans le temps, sont des conditions indispensables à un investissement dans une dynamique de temps long. De plus, les enjeux conjoints de conservation de la biodiversité et de maintien de l’activité pastorale sont souvent au cœur des projets de ces territoires, qui constituent ainsi le socle du dispositif : « Alpages Sentinelles ».
Par ailleurs, au-delà des questionnements spécifiques relatifs au changement climatique, le dispositif « Alpages Sentinelles » représente pour ces territoires un support d’échange et de débat autour de la question pastorale et de ses évolutions.
Des temps de rencontre sont ainsi organisés régulièrement par chacun d’entre eux, à destination des éleveurs, des bergers et de l’ensemble des partenaires et acteurs concernés. Ces moments d’échange font souvent l’objet de documents de communication diffusés ensuite largement sur les territoires.
Pour en savoir plus sur les dynamiques portées par chacun des territoires supports du dispositif « Alpages Sentinelles » :
Parc National des Ecrins / Parc National de la Vanoise / Parc National du Mercantour / Parc Naturel Régional du Vercors / Parc Naturel Régional du Lubéron / Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux / Parc Naturel Régional de la Chartreuse / Site Natura2000 de l’Ubaye / Conservatoire d’espaces naturels Haute-Savoie – Asters
Une volonté de croiser les regards
et de co-construire les connaissances
Au-delà des dynamiques d’échange portées par chacun des territoires, le réseau alpin cherche à développer des opportunités de dialogue pour croiser et valoriser l’ensemble des savoirs empiriques, techniques et scientifiques :
- Les tournées de fin d’estive sont des lieux d’échange sur le terrain, qui mêlent, selon les alpages, les questionnements et les apports des éleveurs et bergers, des techniciens pastoraux, des gestionnaires d’espaces protégés ou encore des chercheurs.
- Les groupes de travail thématiques permettent également l’élaboration d’une culture commune autour de l’alpage et des questions climatiques, et la co-construction d’outils techniques et méthodologiques diffusables auprès d’un large public.
Pour aller plus loin, le dispositif « Alpages Sentinelles » souhaite mieux valoriser les savoirs empiriques issus de l’expérience des bergers et des éleveurs, expérience construite sur le temps long et ancrée dans des contextes territoriaux multiples. La question du regard porté par les bergers sur les végétations, leur complémentarité au sein d’un alpage et leur sensibilité au changement climatique, constitue un premier volet de recherche que le dispositif souhaite développer.
Les apports de la sociologie
sur un programme de long terme
Traiter de la question du changement climatique et de ses impacts environnementaux et socio-économiques implique d’ancrer les travaux et les dynamiques d’échange sur le temps long, à des échelles géographiques assez vastes. C’est ce qui fait à la fois la richesse et la complexité de programmes tels que le dispositif « Alpages Sentinelles ».
Cette dimension de long terme interroge la capacité du dispositif à conserver sur le temps long les moyens organisationnels et financiers nécessaires à la conduite des actions. Elle pose également la question du maintien de la motivation individuelle de chacun des acteurs impliqués, au service de la dynamique collective du réseau, au quotidien et d’année en année.
Un travail de recherche en sociologie est en cours à INRAE pour traiter de la dimension affective de l’investissement professionnel dans des dispositifs tels qu’« Alpages Sentinelles » : Quelles sont les émotions exprimées par les participants et comment sont-elles gérées ? Entre espoir et lassitude, comment maintenir une dynamique de réseau sur le temps long ?
Rythmer le long terme par des échanges réguliers, des productions collectives et des temps forts de mobilisation, semble essentiel pour maintenir une motivation personnelle et un investissement professionnel de tous. Le travail d’animation, à l’échelle du réseau et sur chacun des territoires, est donc un élément central de la réussite d’un tel dispositif.
Un réseau qui bénéficie
d’un soutien institutionnel fort
Le cadre financier du dispositif évolue avec les années et est renouvelé au fil des appels à projets. Le réseau bénéficie depuis sa création d’un appui essentiel des partenaires politiques et financiers suivants :
- L’Union Européenne : Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) mobilisé dans le cadre du Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA).
- L’Etat français :
Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), dans le cadre de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) portée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
Fonds de l’Office Français de la Biodiversité, dans le cadre du projet « Sentinelles des Alpes ». - Les Régions alpines, associées à la déclinaison des politiques publiques européennes et nationales sur les territoires alpins.
- Le Labex Innovations et transitions territoriales en montagne (ITTEM), porté par les Universités Grenoble Alpes et Savoie Mont-Blanc et par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) .
En complément, les moyens humains et financiers nécessaires à l’ensemble des suivis de terrain, qui représentent une part significative des coûts globaux du dispositif, sont assurés aujourd’hui directement par les structures territoriales. INRAE soutient également fortement le dispositif en mobilisant du temps de ses équipes sur diverses fonctions supports scientifiques, techniques et administratives.